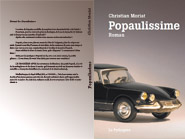Le code de la propriété
intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées
à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale
ou partielle faite par quelque procédé que
ce soit, sans le consentement de l'auteur ou des ayants cause, constitue
une contrefaçon sanctionnée
par les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété
intellectuelle.
Le grand retour
Chapitre 3
Démarches
Gilbert Durand et sa femme Thérèse au grand cœur,
révoltés par la morgue et l'inhumanité des
Lebon, m'ont invité chez eux sans plus de façon. Et
j'y suis depuis près d'une semaine.
Avec leur aide, nous avons entrepris diverses démarches pour
rentrer en possession de la maison familiale. La première
a consisté en une visite auprès de Noël Chambon,
le maire de Varèges. Lequel nous a expliqué que le
succès de notre entreprise allait être plus difficile
à obtenir qu'on le pense. Car les Lebon se sont rendus acquéreurs
du 22 de la rue Jonquères en toute légalité.
Du moins dans cette époque troublée. Le tout obtenu
à un prix fort avantageux auprès des autorités
françaises sous occupation allemande. Aussi sera-t-il compliqué
de les en déloger. D'autant plus qu'ils ont beaucoup d’influence
dans le milieu politique et celui des affaires. Et qu'en conséquence,
ils vont indubitablement bénéficier de nombreux appuis.
Sans oublier qu'ils emploient une trentaine de Varègeois,
qui ne demanderont qu'à soutenir leur employeur. Lequel leur
offre un travail qui ne court pas les rues. Même si le fait
de rendre à David sa propriété n'aura aucune
incidence sur eux, puisque la restitution d'un bien privé
n'aura aucune incidence sur la bonne marche de la scierie.
- Mais le fait qu'ils ne l'habitent qu'occasionnellement, plaide
en ta faveur, argumente mon protecteur. Même qu'ils cherchent
à la louer.
- Effectivement, c'est un point positif, lui répond le premier
magistrat de Varèges. Mais suffira-t-il ? Je l'ignore.
Aussi nous conseille-t-il de contacter Maître Gibeau, afin
de nous éclairer sur les différentes démarches
à suivre pour résoudre cette épineuse affaire,
qui consiste à la restitution d'un bien familial acquis,
preuve à l'appui, sous le gouvernement de Vichy.
L'étude du notaire étant
à deux pas, nous nous y rendons sans plus tarder. L'édifice
est reconnaissable à son double panonceau doré à
l’effigie de la République française, apposé
sur la façade; lequel représente la Liberté
sous les traits d'une Junon assise tenant dans sa main le symbole
de la justice, sous la forme d'un faisceau de licteur. C'est ce
qui m'avait été expliqué par Gilbert à
qui j'avais naïvement demandé sa signification.
- Avez-vous rendez-vous ?
C'est le clerc qui nous reçoit. Un jeune homme grand et maigre
comme un coup de trique. Au visage sec et étroit. Et aux
oreilles décollées. Il vient de s'adresser à
nous. Raide comme la justice, dans sa blouse grise de maître
d'école. Ce qui impressionne c'est son obséquiosité
surfaite qui, grotesquement, conduit le personnage à grossir
sa charge de sous- fifre. À telle enseigne que je l'ai pris
pour le notaire en personne.
- On n'en a pas, répond mon protecteur.
- Vous auriez dû.
- On ne savait pas.
- Qui dois-je annoncer ?
- Gilbert Durand, pour le compte de David Adler.
- Attendez. Je vais voir si maître Gibeau peut vous recevoir.
Demi-tour. Et le voilà parti. Nous abandonnant devant la
double porte de l'office notarial.
Aussi suis-je étonné par celle qui donne sur la salle
d'accueil, qui est tout en cuir renforcé.
Ce qui en impose à l'enfant que je suis. Paraît-il
que c'est pour une question de
confidentialité. En d'autres termes, pour ne pas que l'on
entende ce qu'il se dit derrière. C'est ce que m'apprend
encore mon mentor.
Une fois le clerc de retour, non sans cérémonie, il
nous introduits auprès de l'officier public. Il s'agit d'un
homme d'une cinquantaine d'années, replet, aux cheveux grisonnants
et au sourire engageant. Tout le contraire de son collaborateur,
dont les fonctions consistent en l'accueil des clients et à
la préparation puis à la rédaction des actes
notariés, confiés par son supérieur. C'est
ce que Gilbert me fera encore savoir plus tard, qui déclare
qu'il ne faut pas que je me laisse intimider par l'adjoint de maître
Gibeau.
- Asseyez-vous, dit le notaire.
Après avoir disparu momentanément
dans la verte profondeur des fauteuils de moleskine, mon conseiller
de dévoiler l'objet de notre démarche, tout en donnant
au préalable un rapide aperçu de mes antécédents
: enfant né de parents juifs, détenu au camp de Bergen-Belsen,
enfui d'un train en pleine campagne allemande, puis récemment
arrivé dans la commune après un très long voyage
effectué les trois quarts du temps à pied et qui se
retrouve à la porte de la maison familiale, occupée
impunément par la famille Lebon.
Après s'être éclairci
la gorge, le notaire de déclarer qu'en effet, il a en sa
possession l'acte de vente remis aux nouveaux propriétaires
- Marcel et Huguette Lebon. Mais que, suite aux nouvelles dispositions
prises après la Libération, je ne devrais pas tarder
à rentrer en possession de la maison.
Aussi précise-t-il qu'il va écrire sans tarder à
l'antenne troyenne des affaires juives de la préfecture,
spécialisée pour le recouvrement des maisons et des
biens.
Propos qui me fait entrevoir des jours moins sombres. Je ne devrais
donc pas coucher sous les ponts. En dépit des propos alarmistes
du maire.
Quant à recouvrer l'entière
propriété des biens confisqués; lesquels consistent
en meubles de valeur et en œuvres d'art, dont de nombreuses
toiles de maître, cela risque d'être plus compliqué.
Le directeur de la scierie les ayant soit vendus en France ou à
l'étranger, soit dissimulés dans des endroits connus
de lui seul.
Puis, étant mineur, il demande
à Gilbert s'il accepte d'être mon tuteur. Lequel acquiesce,
comme si cela allait de soi. Ce qui lui vaut de ma part un regard
plein de reconnaissance. Pendant que notre juriste lui fait noircir
plusieurs formulaires et signer quelques papiers.
Enfin, ce dernier de nous apprendre
que, sans distinction idéologique, les responsables de "l'Union
des Juifs pour la Résistance et l'Entraide", placée
sous la présidence de Joseph Minc, ont créé
la CCE ou "Commission Centrale de l'Enfance". Organisme
chargé de la recherche d'enfants juifs, la plupart du temps
cachés dans des familles d'accueil - qu'ils soient fils ou
filles de fusillés ou de déportés, ou n'ayant
pas retrouvé leur famille -, afin de leur apporter aide et
secours. De manière à participer à leur reconstruction
physique et psychologique. Notamment sous la forme de maisons d'enfants,
de patronages ou de colonies de vacances.
Ce qui a priori me concerne peu ou prou. C'est ce que nous lui faisons
objecter.
- Certes. Néanmoins, poursuit-il, l'association pourra épauler
votre jeune protégé en lui donnant des conseils quant
à la reconnaissance de la propriété matérielle
de ses parents. Et d'effectuer des recherches concernant sa mère.
Ce qui n'est pas négligeable.
Pour terminer, il conseille à Gilbert de prendre contact
au plus tôt avec l'AFPBA
(Association de restitution des Biens juifs). Et pourquoi pas, de
se rendre dans les bureaux d'achat parisiens mis en place par le
gouvernement de Vichy, lieux où les biens de Juifs spoliés
sont proposés à la vente. Afin de tenter de reconnaître
les objets ou collections qui leur ont été dérobés.
Notamment les biens culturels. Dont le fameux Steinway, qui a disparu.
Selon lui, plus de huit mille pianos ont été volés
en France, entre 42 et 44, dont certains sont actuellement entreposé
dans le sous-sol du Palais de Tokyo à Paris.
Quoi qu'il en soit, il nous informe que tout devrait rentrer dans
l'ordre. Mais que ce sera long, car la France est en reconstruction.
Aussi n'y a-t-il plus qu'à attendre.
Chapitre 4
L'attente
Cela va faire un mois que je vis chez mes voisins. Lorsque, un beau
matin, le facteur apporte un courrier à mon tuteur pour lui
signifier que je vais pouvoir rentrer en possession de la maison
familiale. Le propriétaire de la scierie ayant été
sommé de quitter les lieux sous huitaine.
Je dois donc patienter encore. Mais,
quelque chose me préoccupe: comment vais-je pouvoir y rentrer,
vu que personne ne m'a remis les clefs ? Vais-je devoir repasser
par la cave de la remise ? Ce que mon tuteur - après avoir
rempli les dernières formalités, il vient d'être
légalement reconnu comme tel -, me déconseille formellement.
Celui-ci m'expliquant qu'il serait malvenu de se mettre en porte-à-faux
vis-à-vis de la loi. Parce que par la suite, cela risquerait
de compliquer la situation avec un Lebon qui, inéluctablement,
cherchera à se venger, en utilisant tous les artifices possibles
et imaginables pour gagner du temps. Le bougre en serait bien capable,
étant données ses nombreuses relations.
- Pour l'instant, le légitime propriétaire, c'est
encore lui, explique Gilbert. Mais dans huit jours, tu pourras enfin
disposer de ton bien.
- C'est bien long.
- Le plus important, rassure-t-il, c'est l'acte de propriété
que le notaire a envoyé. Puis, lorsque tu seras majeur, ta
mère et toi,vous pourrez rentrer de plein droit en possession
de votre bien.
- Pas avant ?
- Pourquoi ? Tu n'es pas bien chez moi ?
- Ce n'est pas cela, mais...
- Je te comprends. À ta place, je serais aussi impatient
que toi.
Ensuite, il me pose des questions
d'ordre matérielle. Du genre:
Est-ce que je n'aurai pas peur d'habiter seul une si grande maison
?
- Quand on revient de Bergen-Belsen, la peur ne fait plus peur (Je
fanfaronne).
Même si je dois avouer que je connais des nuits agitées,
avec des cauchemars récurrents qui me réveillent encore
en sursaut.
Même si je reconnais qu'il me faut un certain temps avant
de réaliser que je ne suis plus dans mon block. Et qu'il
me tarde de voir l'aube se lever.
Il m'est arrivé à plusieurs reprises de me lever,
entre quatre et cinq heures du matin, pour me rendre sur la place
d'appel, prêt à partir pour le Kommando. Puis de me
recoucher après avoir réalisé que je n'étais
plus détenu en pays nazi.
Même s'il me faut encore admettre que la moindre détonation
me fait sursauter. De quelque nature qu'elle soit : pétarades
de voiture, passage d'un avion, ou autres pétards dont raffolent
les enfants.
Quant à sa femme, elle s'inquiète
aussi des hivers. Comment vais-je faire pour me chauffer ?
- Je ne chaufferai pas toutes les pièces. Je compte installer
le lit au rez-de-chaussée. En plus, lorsque j'avais traversé
dans la cave, je m'étais aperçu qu'il restait beaucoup
de charbon. Ce qui est normal, puisque, comme les Lebon n'habitent
notre maison qu'occasionnellement, le combustible est épargné
d'autant.
Enfin, son mari de m'informer, qu'en tant qu'éventuel orphelin,
l'état, grâce au soutien de la CCE, devrait prochainement
m'allouer une pension. Toutefois il me prévient que la France
est pauvre et que vu le nombre de personnes qui vont en bénéficier,
il ne faudra pas que je m'attende à une somme mirobolante.
- J'en ignore le montant, mais si elle suffira à te nourrir,
à t'habiller et à financer tes études, je ne
pense pas qu'elle soit suffisante pour payer ton chauffage.
- J'irai en forêt, couper du bois.
- Tu risques d'y rencontrer pas mal de monde. Tu penses bien que,
pendant l'Occupation, les Varègeois, qui ne s'en sont pas
privés, vont continuer à jouer aux bûcherons.
D'autant plus que la plupart des forêts sont propriétés
de particuliers. À part les bois communaux, bien entendu.
Il faudra se renseigner. De toute façon, tu sais que ma porte
t'est grande ouverte. Surtout pendant la période des grands
froids. Puisque tu as l'intention de nous quitter. Enfin, tu fais
comme tu veux, ingrat ! ajoute-t-il dans un sourire.
Chapitre 5
Une histoire de clefs
Huit jours viennent de passer. Il est temps de rejoindre ma maison.
Hélas ! Lorsqu'on se présente devant la porte, c'est
pour constater qu'elle est fermée - on s'en serait douté.
Comme Gilbert m'interdit de passer par la cave de la remise, titre
de propriété en main, nous en rendons compte aux gendarmes
de la brigade de Varèges.
L'adjudant, qui comprend la situation, désigne deux fauteuils
puis nous demande de l'attendre.
- Je vais aller chercher les clefs, décide-t-il fermement.
Et le voilà parti avec l'un de ses collègues.
Une fois encore, je dois patienter.
Un quart d'heure...une demi-heure...une
heure... On commence à désespérer.
Une heure et demie... une heure quarante-cinq... On n'y croit plus...
Deux heures.... Enfin ! Des pas au dehors. Une porte qui s'ouvre.
Ce sont nos deux gendarmes qui viennent d'entrer, passablement énervés
:
- Voilà les clefs, déclare l'adjudant, en les jetant
sur son bureau. Je le retiens ! Lebon, il se fout du monde. Tenez,
enchaîne-t-il, signez ici, fait-il en nous tendant un reçu
en double exemplaire. C'est qu'avec un énergumène
pareil il faut se méfier.
Il nous raconte que son subordonné
et lui se sont rendus à son domicile, qu'ils ont rencontré
son épouse ; laquelle leur a déclaré que les
clefs, elle ne les avait pas et que son mari était le seul
à savoir où elles étaient, mais qu'il était
parti dans les bois de L'Arclais afin de superviser une coupe.
Après s'être fait expliquer
l'endroit exact, ils s'y sont rendus. Visiblement, le bougre n'était
pas à l'endroit indiqué. Sur les indications de l'un
de ses employés, ils ont enfin réussi à mettre
la main dessus.
D'abord, il avait cherché à tergiverser :
- Les clefs ? Quelles clefs ?
- Celles du 22 de la rue de la rue de Jonquères.
- Pourquoi faire ?
- Vous avez reçu un courrier vous sommant de libérer
la maison.
- Peut-être bien.
- Les clefs. Il nous les faut.
Alors, il a raconté qu'il ne
les avait pas sur lui. Que rien ne pressait. Et qu'il les rapporterait
demain à la gendarmerie.
Devant tant de mauvaise foi, l'adjudant l'a prié de monter
dans leur fourgonnette, puis ils sont allés chez lui, de
concert, afin de les récupérer. Et c'est sous l’oeil
outré de madame Lebon que celles-ci leur ont été
remises, contraints et forcés qu'ils étaient, sans
un dernier baroud d'honneur de cette dernière :
- Vous n'avez pas honte ? Mon mari, reconduit chez lui, entre deux
gendarmes, comme un vulgaire voleur. Et dans une fourgonnette de
la gendarmerie, en plus. Que vont penser les gens ? Ça ne
se passera pas comme ça !
Ce qui conforte Gilbert dans son opinion :
- Tu vois, petit. Dans des cas pareils, mieux vaut faire appel aux
forces de l'ordre. Qu'est-ce que tu aurais fait, face à de
tels individus ? Puisque les gendarmes eux- mêmes ont eu bien
du mal à faire respecter la loi. Nul doute qu'en pénétrant
chez toi par effraction, comme tu l'avais souhaité, même
si la maison t'appartient, nul doute qu'ils auraient porté
plainte. Après, il y aurait eu procès. Et Dieu seul
sait quand tu serais rentré en possession de ton bien. Vu
que Lebon et ses avocats se seraient entendus pour faire traîner
les choses en longueur.
Après avoir remercié
le chef et son adjoint, nous voilà de retour "Chez moi".
Hélas! Les clefs n'entrent pas dans la serrure. Apparemment,
ce ne sont pas les bonnes. Ce qui nous vaut un retour immédiat
à la gendarmerie. Gilbert est dans une colère noire.
Quant à moi, qui au camp en a vu bien d'autres, il n'y a
plus grand-chose qui me touche.
- Et puis quoi encore ! Il commence par nous casser les pieds, ce
Lebon. Rentrez chez vous, conseille l'adjudant à mon tuteur.
On y retourne. Et ces bon sang de clefs, de gré ou de force,
on va vous les ramener.
Chapitre 6
Un constat navrant
Retour à la maison.
Cette fois, c'est la bonne clef. Celle-ci de rentrer dans la serrure
sans forcer et de tourner à l’intérieur sans
difficulté.
Ô miracle ! porte de s'ouvrir. J'en suis presque surpris tant
la mauvaise foi d'un Lebon m'avait préparé une nouvelle
fois au pire.
Gilbert et moi rentrons à l'intérieur.
Et les deux bras nous en tombent. Plus de meubles du tout. Le désert.
Il n'y a plus rien. À part un silence épais que vient
troubler l'écho de nos voix dépitées, renvoyées
par la nudité des murs.
Dans le salon, où sont donc passés le canapé
Louis XV ? Les fauteuils en palissandre? Et la grande table? Qu'ont-ils
fait des rideaux et des double-rideaux pendus aux fenêtres
?
Et dans la cuisine, disparus chaises, table et coucou !
Démonté le vaisselier. Plus là non plus, la
vaisselle du placard. Où sont donc casseroles, poêles,
fourchettes, cuillères et couteaux ? Sur les étagères
ne restent plus que deux ou trois assiettes ébréchées
et quelques verres.
Quant au four, lui aussi, il s'est envolé.
Plus rien non plus dans les chambres. Plus d'armoires. Plus de lits.
Plus de draps.
Enfin, une dernière visite
au grenier m'apprend que certains meubles, parmi les moins endommagés,
ont également été pillés.
Au fait, j'y pense... une idée d’apparence saugrenue
me vient à l'esprit... Non...! Ils n'auraient tout de même
pas fait cela ?
Aussi quelle n'est pas la surprise de Gilbert, de me voir filer
en direction de la remise. La cave... Vite, vite ! La cave...! Hélas
! Je l'aurais parié. Ils ont emporté jusqu'au tas
de charbon !
- Il faut faire constater cela par
les autorités compétentes. Dommage qu'à Varèges,
il n'y ait point d’huissiers. Qui contacter ? Le notaire ?
- ce n'est pas de sa compétence. Le maire, pourquoi pas ?
Les gendarmes, plutôt, vu que ce sont eux qui s’étaient
chargés de rapporter les clefs.
Une fois de plus, nous faisons appel
à ces derniers. Lesquels, touchés par mon dénuement,
acceptent de se déplacer.
- Forcément, déclare le chef, après avoir visité
toutes les pièces. Sans pouvoir préjuger de ce qu'il
y avait avant, nous ne pouvons mentionner que ce qu'il reste. Cela,
on peut le faire. Et ce sera vite fait, vu qu'il n'y a plus rien.
Ou presque. Ce qu'il faudrait, ce sont d'anciennes photos qui auraient
été prises, avec des meubles à l'intérieur.
En avez-vous ?
- Hélas, non ! Ils nous ont pris jusqu’à notre
album-photos, déploré-je.
- Dommage.
Le temps de dresser une liste plus
que sommaire, le constat est aussitôt rédigé
sur une feuille de papier volante.
- Ce qui n'a guère de valeur officielle, en cas de procédure,
insiste-t-il. Mais c'est toujours ça. Au moins nous avons
mentionné que la maison est pratiquement vide. L'était-
elle avant qu'ils n'en deviennent acquéreurs ? Personnellement,
nous, forces de l'ordre, nous l'ignorons.
J'aimerais affirmer le contraire. Mais, comme je m'y suis introduit
frauduleusement, je serais en faute. Aussi, suis-je contraint de
me taire.
Par contre, mon tuteur, qui pense
à tout, déclare que maître Gibeaux, est forcément
au courant du contenu de la maison, vu que c'est lui qui avait conclu
la vente. Ce qu'admettent les gendarmes.
- Vous avez raison, reconnaît l'adjudant. Je vais retourner
à la brigade pour faire taper le constat à la machine.
Puis je vous en ferai parvenir une copie.
Et le voilà reparti avec son subalterne.
- Tu veux toujours habiter ici ? me
demande Gilbert sceptique.
- Oui.
Constatant ma détermination, de retourner vivre dans la propriété
de mes parents, avec l'aide de sa femme, ils font toue deux l’inventaire
de ce qu'ils pourraient me prêter, afin de pouvoir décemment
vivre décemment seul. Ce qui nous vaut d'effectuer plusieurs
allers et retours entre les deux maisons voisines.
Le lit-cage, sur lequel je dormais, des draps, des couvertures,
bien que je persiste à dormir par terre - une réadaptation
s'impose, mais ce n'est pas encore d'actualité.
- On va le mettre dans le salon, tu ne vas pas t'amuser à
chauffer les chambres du premier étage. C'est bien ce que
tu souhaitais, par souci d'économie ? N'est-ce pas ?
Une table, deux chaises - « Au cas où tu recevrais
» -, un vieux réchaud, une commode, deux ou trois casseroles,
quelques assiettes, des verres, des couteaux, des cuillères
et des fourchettes, un paquet de bougies et une lampe à huile
- l'électricité n'étant pas prêt d'être
rétablie. Et le tour est joué.
Ne reste plus que le bois à aller chercher, comme je l'avais
prévu. Ce qui ne constitue pas un problème majeur,
vu que Varèges est "une cuvette" entourée
de forêts.
- Pour le charbon, on verra plus tard. Dès que tu auras reçu
le premier versement de ta pension. J'espère qu'elle sera
suffisamment conséquente pour te payer une ou deux tonnes
de charbon pour cet hiver. En attendant, ta chaudière, on
va l'alimenter en bois. Ne reste plus qu'à aller le couper.
Et c'est ainsi qu'avec l'aide de mon
dévoué voisin, tous deux, munis de haches, de serpes
et d'un passe-partout, nous nous enfonçons dans les taillis,
à la recherche de l'essence idéale.
Avec quelques règles qu'il tient à préciser,
selon lesquelles les résineux sont à proscrire en
raison de leur sève trop abondante, qui encrasse les parois
des appareils de chauffage. Sans oublier bouleaux, aulnes, tilleuls,
peupliers, merisiers à combustion trop rapide. Leur préférant,
par contre, chênes, charmes, hêtres, frênes, ormes
ou érables aux fibres resserrées, de meilleur rendement.
Même si la combustion prend davantage de temps.
Justement, un charme, en voilà un.
Au travail !
Mais, après tant de privations et de mauvais traitements,
en ce qui me concerne, c'est Gilbert qui effectue le plus gros du
travail. Car, je me fatigue très vite.
Ensuite, une fois l'arbre coupé, scié et débité,
il est immédiatement chargé sur le plateau de sa voiture
à bras - de crainte qu'en le laissant sur place, il ne nous
soit dérobé, Gilbert n'ayant ni remorque, ni voiture.
Aussi, plusieurs voyages sont-ils
nécessaires, avant d'entreposer les bûches dans la
remise, afin de surmonter un éventuel hiver potentiellement
rigoureux, à défaut de charbon.
- Tu vois, David, tu passerais la mauvaise saison chez moi, tu n'aurais
pas besoin de te dépenser autant. Tête de mule ! récrimine
mon voisin, en me voyant peiner. Car pour stocker les quelques stères
de bois dans la remise familiale, après les avoir fendus
et débités, il faut traverser le couloir et la cour.
Ce qui est particulièrement éreintant.
- Tu as bien besoin de te remplumer, constate-t-il. Thérèse
va aller faire tes courses. Ainsi, tu auras de quoi garnir ton garde-manger.
Et le voilà parti seul, pour un ultime voyage. Car n'en pouvant
plus, je me fois forcé de rendre les armes.
Chapitre 7
Obsessions
À la demande de maître Gibeau, Noël Chambon m'a
contacté pour m'annoncer qu'ayant été ému
par ma situation, ainsi que par les atermoiements des Lebon, quant
à la restitution de ma maison, il allait tout mettre en œuvre
pour retrouver maman. Aussi, après avoir adressé divers
courriers en direction d'associations juives, attend-il des réponses
des leur part.
Il a même écrit à l'hôtel Lutetia qui,
dès avril 1 945, a été transformé en
centre d'accueil, par Sabine Zlatin - la "dame" qui, avec
Miron, son mari, encadra la colonie des enfants d'Izieu -, afin
d'accueillir les survivants des camps de concentrations nazis. Et
de fournir aux familles des informations sur des proches potentiellement
détenus en même temps qu'elle.
Le maire craint qu'après la libération du camp de
Bergen-Belsen par les armées britanniques, elle n'ait été
envoyée à l'étranger. Si toutefois elle a pu
échapper au typhus. Ce qui risque de passablement compliquer
les choses quant à son rapatriement.
Une fois de plus, il me faut attendre.
Toutefois, au regard de ce que j'ai
vécu, je dois avouer que s'émousse ma volonté
de vivre. Seul l'espoir d'un retour de ma mère me soutient.
J'ai beaucoup pensé à ce poncif qui prétend
qu'un jeune a toute son existence devant lui. C'est faux. En 44,
date à laquelle ma famille et moi avons été
arrêtés, ma vie était derrière moi. Et
pour le détenu que j'étais, la mort seule était
devant. Même qu'elle était en moi, vu que je l'avais
intégrée depuis l'obligation du port l'étoile
jaune, ce bout de tissu qui sacrifia tout un pan de ma jeunesse.
Aussi, plus rien maintenant ne me
faisant envie, je passe les trois quarts du temps allongé
sur mon lit. Sauf... pour me rendre quotidiennement au cimetière.
Ce qui est extrêmement curieux, vu qu'aucun membre de ma famille
n'y est enterré. À part quelques Varègeois
de mes connaissances et qui, aujourd'hui, me manquent.
C'est une envie. Un besoin. Comme si je voulais faire craquer la
gangue qui, malgré ma libération, me tient encore
enfermé. Car, j'ai tellement côtoyé la mort
qu'elle ne m'a jamais complètement quitté. Ce qui
fait que je me sens plus proche des morts que des vivants. À
telle enseigne que je leur parle, que je les fais parler et qu'ils
me répondent.
Est-ce à force d'avoir vécu
tous les jours au milieu des cadavres de Bergen ? D'avoir joué
autour d'eux dans le camp, comme tous les gosses de mon âge
? N'hésitant pas à les enjamber ou à les déplacer,
quand leur présence contrariait nos jeux. Ou même parfois
à marcher involontairement dessus. Il est vrai qu'il y en
avait tant que leur présence finissait par ne plus nous déranger.
Tant ils ont fait partie de notre quotidien.
Ou est-ce parce que je me savais moi-même
en sursis ? Lors que chaque matin, je me disais : «Est-ce
que c'est pour aujourd'hui ? Est-ce que c'est pour demain ? »,
en regardant la fumée noire et pestilentielle qui s'échappait
d'un crématoire chauffé à blanc.
Alors, on s'amusait. Pariant sur celui
qui vivrait le plus longtemps. Histoire de provoquer nos geôliers
- une façon dérisoire et bien à nous de résister
en somme. Mais c'était notre seul pouvoir.
Néanmoins, je me dois rétrospectivement de le confesser
: parfois, il s'en était fallu de peu que je ne passe de
l'autre côté. Notamment quand, à bout de force
et de volonté, je tutoyais la ligne rouge, celle à
ne pas dépasser, sous peine de basculer. Lorsque le soir,
après être allé au bord de moi-même, je
me demandais s'il ne valait pas mieux renoncer.
Combien j'en ai vu de mes camarades
manquer l'appel du matin. Tel était présent la veille,
qui était absent le lendemain. Et tout ça pourquoi
? Pour rien : un geste, un regard, une casquette pas assez vite
retirée devant un SS, une glissade dans la boue, lors qu'on
nous faisait transporter des charges plus lourdes que nous, un retard
à l'appel, une égratignure subitement infectée...
Notre existence qui indisposait la race des Seigneurs ne tenait
qu'à un fil. Et chaque jour qui passait était une
victoire sur eux arrachée. Tant vivre tenait du miracle.
Heureusement pour moi, j'avais l'indulgence d'un gardien et de son
chien. Et je n'ai jamais su qu'elle en était la raison ?
Sinon, sans traitement de faveur de sa part, je pense que je ne
serais pas rentré. Tout le monde n'a pas eu cette chance.
Toujours est-il que, depuis mon retour,
j'ai l'étrange sensation que les morts m'appellent. Alors,
je me rends au cimetière où je passe des heures à
errer dans les allées, au milieu des tombes. Notamment dans
le carré militaire, au pied des sépultures de ceux
qu'on appelait "les Poilus". Ceux de la grande guerre.
Ou auprès des sépultures des civils du nord, bombardés
par des Italiens, Place de la Mairie, durant l'Exode.
Que d'images morbides remontaient
à la surface !
À ce sujet, Gilbert m'a une fois raconté que son grand-père,
en pleine débâcle, avait été interpellé
par un civil, sorti tout droit des urinoirs, plaqués contre
le mur de la maison commune, et qui, une main plaquée contre
son ventre ouvert, tentait vainement de contenir le flot rouge qui
s'en échappait. Lequel inlassablement de répéter
: «Un coup de main. Donnez-moi un coup de main, s'il vous
plaît ».
Que de victimes le bombardement n'a-t-il point fait à Varèges,
durant mon séjour forcé en camp de concentration !
C'est du moins ce que les Durand m'ont raconté. De toute
façon, les tombes blanches et bien alignées du carré
militaire, sont là pour en témoigner.
Ou tel autre témoignage d'un
fils de paysans évoquant l’étrange fascination
éprouvée par son vieux père pétrifié,
au beau milieu de la cour de leur ferme, face au ballet de l'aviation
italienne qui tournoyaient au-dessus de sa tête, en lâchant
leurs bombes meurtrières - leur ferme étant située
derrière la ligne de chemin de fer, sur laquelle les Transalpins
avaient jeté leur dévolu. Tellement statufié
qu'il était, il ne savait pas s'il devait avancer ou reculer.
Dans son incapacité à courir pour s'abriter.
De ces histoires, je m'en nourris.
Ayant une forte propension à l'écoute de leur souffrance.
Et je me dis qu'il n'y a rien de pire que la mort quand elle est
donnée par un tiers qui dispose de vous, vous considérant
comme un objet sans valeur. Non sans avoir préalablement
joui de votre douleur, suite aux tortures par lui infligées.
Le tout sans avoir eu la possibilité de vous défendre.
Telle était la prérogative que s'était octroyée
la race supérieure. Celle qui avait la haute main sur votre
existence.
Avec en vous le profond sentiment que vous ne vous appartenez plus.
Avec en vous le profond sentiment de votre propre insignifiance
et de votre inexistence.
C'est ainsi que je passais mon temps,
au champ municipal du grand repos, conversant avec les défunts
sous la pierre endormis. Lesquels ont au moins eu cette chance d'avoir
une tombe, gravée à leur nom. Contrairement à
tous ces immenses tas de cadavres anonymes que des lames de bulldozers
poussaient devant elles, avant de les faire basculer dans la profondeur
des charniers du Lager. Histoire de déblayer le terrain¹.
Combien elles étaient ridicules toutes ces dépouilles.
Dans leur impudeur. Dans leur grotesque apparence. Quand elles étaient
entières. Car quelquefois, il manquait qui un bras, qui une
jambe, quand ce n'était pas le crâne entier qui, aux
corps faisait défaut.
Mais tous avaient les yeux grands
ouverts et la bouche béante. Certains restant figés
dans leur douleur. Parfois dans leur étonnement. Lors que
d'autres, édentés en partie, affichaient un horrible
rictus. Donnant l'impression que de leurs bourreaux, ils se moquaient.
Ce qui faisait rire ces derniers, avec certainement le regret qu'ils
avaient de ne pas les faire mourir une nouvelle fois.
C'est ce que quotidiennement, nous autres concentrationnaires, avions
sous les yeux, quand le nombre faisait exploser un four crématoire,
qui ne suffisant pas, tournait vingt- quatre heures sur vingt-quatre.
L'odeur de Bergen-Belsen ne s'oublie pas.
Sinon, pour gérer l'insuffisance
de moyens, de grands brasiers avaient été allumés
en plein air - une couche de rondins, une autre de cadavres, une
couche de rondins, une autre de cadavres... et ainsi de suite. Avec
leurs cendres, et quelques os échappés de la flamme,
qui partaient enrichir l'étang voisin.
Ainsi l'avait décidé le commandant du camp, le SS
Hauptsturmführer Josef Kramer, surnommé "La Bête
de Belsen", aidé par une partie du personnel SS d’Auschwitz-Birkenau,
arrivée en renfort.
Sans oublier non plus le lazaret ou
baraquement des malades, avec ses médecins fous, qui se livraient
à des expériences, au mépris de la vie des
réclusionnaires. Dont le détenu infirmier Karl Rothe
qui, sur ordre des SS, tua des centaines de déportés
avec ses injections de phénol.
J'y avais séjourné deux jours pour soigner une blessure
à la jambe. Ayant vite compris qu'il ne fallait pas s'éterniser
dans ce "quartier des mal-en-point", infecte bouillon
de culture où grouillaient les germes du typhus et de la
dysenterie, je n'avais pas tardé à déclarer
aux infirmiers que j'étais guéri. Pommade "passe-partout"
- unique médicament dont "les soignants" disposaient
-, et bandes de papier en guise de bandes Velpeau, ayant été
les seuls soins dont j'avais pu bénéficier.
Seul le temps ?uvra en faveur de ma guérison.
Aussi comprend-on les raisons qui
me poussent à inlassablement visiter le cimetière
de Varèges. Instinct inconscient et naturel. Comme un besoin,
ai-je dit. Celui de me déshabiller d'un passé que
mes voisins d'Outre-Rhin m'avaient fait enfiler. Contre mon gré.
...........................................................................À
SUIVRE

![]()
 Épuisé
Épuisé Épuisé
Épuisé