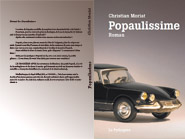Le code de la propriété
intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées
à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale
ou partielle faite par quelque procédé que
ce soit, sans le consentement de l'auteur ou des ayants cause, constitue
une contrefaçon sanctionnée
par les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété
intellectuelle.
Le grand retour
Le début du cauchemar
Du haut de la grand-côte de Piney, à l'endroit de La
Glacière, le panorama sur Varèges est prodigieux,
qui permet au regard de plonger sur le petit bourg.
Je m'attendais à retrouver mon village tel que je l'avais
quitté en 44. Hélas! J’observe nombre de ruines
- comme il m'a déjà été donné
de le constater au cours de mon périple à travers
l'Allemagne et la partie nord de l'Europe.
L'église Saint Pierre et Saint Paul, notre belle église
gothique semble - hélas! - dans un bien triste état.
Ce qui à la fois me surprend et m'attriste. Que s'est-il
donc passé ?
Renseignement pris auprès d'un terrassier, que je croise
aux abords du cimetière, j’apprends que durant un affrontement
entre chars et infanterie, l'édifice religieux a été
incendié par la faute d'un obus tombé sur une citerne
d'essence abritée sous des platanes implantés aux
abords de son portail. Le saint lieu, d'après ce qu'il me
révèle, a immédiatement pris feu en raison
de sa proximité d'avec les arbres, enflammant du même
coup la toiture qui, suite aux rigueurs climatiques avec ses alternances
gel et pluie, ont provoqué son effondrement.
- Tu ne serais pas le fils d'Isaac
et d 'Hannah Adler, par hasard ? me demande-t-il brusquement.
- Si.
- Me semblait bien. C'est comment ton prénom ?
- David.
- C'est ça.
- Pauvre gosse, qu'il me fait, sans plus de commentaires.
Et le voilà, pic sur l'épaule, m'abandonnant au pied
de la grille du champ du grand repos, qu'il franchit, sans se retourner.
Belle est la guerre, où
partout où j'ai posé mes pas, je n'ai rencontré
que mort et destruction. Finalement, je ne suis guère pressé
de rentrer à la maison, tant je m’attends au pire.
(Le pire, c'est quartier de la Côte d'Argent et rue du Chaillois,
situés dans le proche périmètre de l'église,
que plus tard je le rencontrerai. Avec ses demeures aux trois-quarts
dévastées.)
Je m’inquiète. Dans quel état vais-je retrouver
la mienne ?
Quai Saint Jacques, rues de Brément,
de Blèzes et de Desmoines, partout il y a des brèches
dans le bel ordonnancement des habitations autrefois accolées
les unes aux autres et qui épousaient le capricieux tracé
des voies. À la place, j'observe des éboulis de pierre,
de briques, de bois, de plâtre et de ciment. Finalement comme
partout, dans les contrées que j'ai traversées.
22 rue de Jonquères. Voilà ma maison. Ouf ! Contrairement
à celle qui est située plus en contrebas, celle-ci
n'a pas souffert. J'avais tellement craint pour elle, en voyant
tant de bâtiments détruits. Je suis soulagé.
Elle est telle que nous l'avions laissée, le jour où
les gendarmes étaient venus nous chercher. Et la demeure
voisine également, qui a été épargnée.
De cette arrestation, je m'en souviens
comme si c'était hier. C'étaient deux gendarmes français
et un civil coiffé d'un grand chapeau noir et drapé
dans une sorte d' imperméable de même
couleur, accompagnés de deux soldats allemands équipés
de fusils. Même qu'ils nous avaient dit qu'il était
inutile de fermer la porte, vu qu'on allait revenir, alors qu'au
préalable, ils nous avaient ordonné d'emporter le
nécessaire.
Mes parents et moi, on avait juste eu le temps de prendre notre
valise et nos papiers. Puis on nous avait fait monter tous les trois
dans un camion. Et en route ! Direction la gare de Varèges
où un train nous avait conduit jusqu’à Drancy,
camp de fer et de béton. À l'allure de forteresse.
Avec des barres de grands immeubles, percés d'une multitude
de fenêtres, ceinturant une cour centrale, le tout doté
de cinq tours, dominant l'enceinte, où vivaient la plupart
des familles de gardiens.
On nous avait parqués comme des bestiaux à l'intérieur
de ce champ clos de barbelés, où on avait passé
quelques semaines à subir au quotidien les coups des gendarmes
qui nous frappaient à tour de bras, avec une mention spéciale
pour un chef ivre de cruauté ; lequel nous battait férocement
à l'aide d'une matraque dont jamais il ne se départissait.
Drancy était un camp de transit et de triage, une antichambre
des fours crématoires, où mon père sera assassiné
sur le quai de la gare, suite à son refus de monter dans
le train, lors d'un premier transfert, car il ne supportait pas
qu'on puisse nous séparer.
Par la suite, nous avons descendu
sur Pithiviers, Beaune-la-Rolande, pour finalement échouer
dans l'un des baraquements du camp de Bergen-Belsen, situé
le long de la Lagerstrasse.
Jamais je ne pourrai oublier cette grande plaine humide et nue,
cette terre noirâtre, et sans verdure, balayée par
un vent glacial, qui nous rapportait cette abominable odeur de chair
en décomposition, qui ne nous quittera plus durant notre
"séjour".
Au 22 de la rue de Jonquères,
nos volets sont clos. La porte aussi. C'est curieux, puisque, avant
de partir, si nous avions refermé la porte derrière
nous, nous avions laissé ouvert tout le reste, puisqu’on
nous avait dit qu'on allait revenir. Qui donc a fermé la
maison ?
La clef... Où est-elle ? Profitant d'un moment de distractions
des sbires venus nous arrêter, mon père l'avait cachée
dans une excavation du mur, derrière une brique mal scellée
- comme il était d'usage, lorsque nous devions nous absenter.
Laquelle est-ce, cette brique ?
C'est que je n'en m'en souviens plus. Depuis le temps. Non... Pas
celle-là. Celle-ci non plus... Ah, ça y est. Voyons
si la clef y est toujours...
Victoire, elle est bien là qui n'attendait que le retour
des propriétaires. Belle constance ! Par contre, cela prouve
que ma mère n'est toujours pas revenue. Ce qui m'inquiète.
Vite ! Tiens !? Qu'est-ce qu'il
se passe ? Elle ne rentre pas. Il y a quelque chose qui bloque.
Curieux ! C'est comme si la serrure avait été changée.
Dans la maison voisine, des rideaux ont bougé. Signe qu'on
m'observe. Mais personne de se manifester.
Que faire ?
Deux maisons plus loin, sur la
gauche, je me souviens qu'il y a une grille, qui, auparavant, n’était
jamais fermée, avec un passage entre deux habitations, et
qui s'ouvrait sur une cour - ce qui, fort heureusement, est encore
le cas. Laquelle donne accès à plusieurs logements.
Au fond, s'insinue une allée qui s'immisce entre une enfilade
de dépendances et de jardinets pour s'évaser à
la toute fin, tel le cône d'un entonnoir. C'est l'endroit
réservé aux locataires des appartements pour étendre
leur linge et se rendre vers les lieux d'aisance représentés
par des cabines de couleur grise, façon toilettes de cour
d'école.
Il est toutefois inutile d'aller si loin car sur la droite, se dresse
un bâtiment en torchis tout en hauteur, une remise qui nous
appartient, avec poutres apparentes et soubassement de pierre, utilisée
pour stocker bois et charbon en sous-sol et dotée de trois
pièces, hors rez-de-chaussée, dont une
salle de jeu où je jouais notamment au ping-pong avec mon
père et deux chambre aux étages, sans
oublier son imposant grenier qui s'étend sur deux niveaux.
Or, au pied de l'édifice, il y a un puits qui, bien qu’empiétant
sur le jardinet d'à côté est également
à nous. C'était là qu'autrefois, les habitants
du quartier venaient puiser de l'eau pour leur besoin domestique
- laquelle n'était pas potable. Cette cavité, devenue
par la suite inutile, celle-ci a été comblée,
et une plaque en fonte avait été déposée
à sa surface afin d'éviter que des animaux ne tombent
à l'intérieur.
En passant par dessus, vu qu'elle est à fleur de terre, elle
permet d'accéder à une porte basse, jamais fermée
à clef et qui donne sur la cave intérieure de la remise
que je viens d'évoquer.
J'escalade le grillage à moitié affaissé, franchi
le puits, exerce une violente poussée contre la porte basse
qui résiste - preuve que personne n'a pénétré
par là depuis longtemps. À grands renforts de coups
de pied et d'épaule, et après avoir reçu sur
la tête une avalanche de plâtre et de poussière
issue du plafond, sans compter les toiles d'araignée, que
mon visage essuie au passage, l'obstacle accepte, non sans réticence,
tout en raclant le sol, à libérer un espace suffisant
pour me permettre de passer.
Ça y est. Me voici dans
la cave à charbon. Rien n'a changé.
Après avoir escaladé quelques marches et poussé
une seconde porte, j'accède au rez-de-chaussée, puis
plus loin, après avoir forcé une dernière entrée,
je gagne enfin la courette au sol de brique - terrain de jeu favori
de mon enfance, où se dressait une balançoire aujourd'hui
démontée et où je tournais indéfiniment
à bicyclette autour du massif situé au centre. Me
voici donc à l'arrière de la demeure familiale.
J'avais espéré que la porte vitrée de l'habitat
principal qui, malgré sa vétusté, n'avait point
été changée, n'ait point été
fermée. Hélas ! Ce n'est pas le cas. Mais comme sa
fermeture est assurée par un simple loquet, une forte pression
à son endroit suffit à le faire sauter.
Me voici enfin dans l'enfilade
du couloir où une rangée de tableaux et d'eaux-fortes
autrefois recouvraient les murs, lors qu'en dessous, une quinzaine
de guéridons, de socles et de piédestaux, supportait
toute une ribambelle de plantes grasses, que ma mère entretenait
avec le plus grand soin. Plantes dont je déplore la disparition.
En effet, il n'y a plus rien. Le corridor est un véritable
désert. À l'exception d'une bicyclette et d'une voiture
d'enfants à pédales. Je comprends que la demeure a
été occupée. L'est-elle encore ? C'est ce qu'il
me faut vérifier. Pourtant, lors du raffut occasionné
par le bris du verrou, les occupants auraient dû se manifester.
J'ai beau écouter. Grâce à Dieu, aucun bruit
de se manifester.
À gauche, côté
cuisine. Personne non plus. Le buffet est toujours à sa place,
le four aussi. Quant à l'intérieur du vaisselier,
mise à part une batterie de casseroles et une malheureuse
poêle, je ne reconnais plus rien. Par contre, quelques-uns
de nos anciens verres et de nos anciens bols sont encore bien présents.
Notre horloge coucou aussi, qui trône dans un coin de la pièce.
Par contre, elle ne sonne plus. Les aiguilles se sont définitivement
arrêtées sur une heure vingt-cinq. C'est ce que je
constate au bout de quelques minutes d'attente. Confirmant ce que
j'avais supposé en n’entendant plus son tic-tac régulier.
Ce qui prouve qu'elle n'a pas été remontée.
La position basse des poids, au bout des chaînes en est la
preuve. Les squatteurs sont donc absents.
Si sur la table, la nappe n'est plus la même, par terre, le
carrelage a été remplacé, mais c'est toujours
notre table. Les chaises sont les nôtres également.
Et il y a toujours l'imposante chaudière, à la gauche
d'un placard particulièrement bien achalandé avec
farine, semoule, riz, sucre, boîtes de conserve, entouré
de fait-tout, ainsi que toute une batterie de cuisine - encore la
nôtre.
Dans le salon, je suis fort étonné. Où sont
donc passés nos tableaux de maître ? Notre piano -
un Steinway ? Notre tapisserie d'Aubusson ? Disparue aussi notre
pendule dorée au mercure qui se dressait sur la tablette
de la cheminée en marbre, entre deux chandeliers de même
facture ?
Envolées aussi nos deux statuettes d'angelots en cuivre ?
Et notre comtoise ? Et notre tapis
persan ? Tout est parti. À l'exception du canapé Louis
XV, de nos trois anciens fauteuils en
palissandre aux motifs floraux, de la grande table utilisée
lorsque nous recevions nos invités et d'une demi-douzaine
de chaises à garniture de rinceaux et de fleurs.
La comtoise à l'angle de la pièce, brille encore par
son absence, ainsi que la pendule de Boulle avec sa console fixée
au mur - mon père ayant toujours eu la passion des horloges.
Quant aux fenêtres, rideaux et stores ont été
changés. Même constat dans les trois chambres du premier.
Où, à part la literie, tout est par contre, resté
en l'état. Sauf fauteuils et chaises cannés qui ont
pris la place des nôtres, en moins raffinés.
Même chose pour nos anciens tableaux. Lesquels ont été
remplacés par des chromos de médiocre qualité.
Enfin, après une rapide visite dans le bureau de mon père...
Plus rien dans les tiroirs. Plus rien dans la bibliothèque.
Les ouvrages les plus riches ont disparu. Ne restent sur les étagères,
que quelques livres brochés, à la couverture en capilotade.
Même que plusieurs ont été emportés.
Où est notre album-photos ? Et notre collection de timbres
?
Je suis désespéré. Il faut se rendre à
l'évidence, nos objets de valeur ont été pillés.
Et une famille chez nous, s'est installée temporairement
- semble-t-il. Laquelle est susceptible de revenir, étant
données les provisions encore stockées dans le placard.
Après une visite au grenier,
je constate également l'absence de pas mal de meubles qu'on
avait remontés parce que endommagés. Lesquels, ont
certainement fait le bonheur de pillards qui n'ont pas manqué
de les restaurer avant que de les revendre.
Le cœur gros, je redescends
les marches pour regagner le salon. Je comprends tout : du "Pauvre
gosse" du fossoyeur, jusqu'aux regards curieux des voisins
dissimulés derrière leurs rideaux.
Effondré, je m'endors sur le plancher, à côté
du canapé. Au risque de me faire surprendre par des occupants
qui m'ont l'air dénué de scrupules.
Chapitre 2
Dur est le réveil
- Papa ! Maman ! Y a un gamin allongé par terre !
C'est un garçonnet de six à sept ans qui vient de
pousser ce hurlement de surprise et de frayeur mêlées.
Lesquels me réveillent en sursaut. À telle enseigne
qu'il me faut un peu de temps pour réaliser où je
suis.
Peu à peu, je retrouve mes
esprits. Je ne suis ni dans mon block, ni dans une grange de ferme.
Je suis dans notre maison de Varèges. Où sont donc
mes parents ? C'est alors que tout me revient: mon père assassiné
par les bourreaux et ma mère disparue dans la lueur aveuglante
des projecteurs. Il faut me faire une raison. J'ai marché.
Beaucoup marché. Traversé plusieurs pays, pour arriver
là. Chez nous. Dans notre maison. Une maison par des étrangers
occupée. Je suis seul. Seul au monde. Et je dormais sur le
plancher, habitué que je suis à ne plus supporter
le moelleux des lits et des canapés, quant un sale gamin
est venu corner dans mes oreilles.
- Maman ! Papa ! Venez vite. Y a quelqu'un dans le salon.
Mon trublion, une fois sa surprise
digérée, est outré devant tant de culot. Ses
yeux lancent des éclairs. C'est un merdaillon de six à
sept ans, arrogant et godichon de surcroît, dont l'élégance
du costume ne parvient pas à masquer la sottise.
Il est vêtu d'une chemise bleu clair à manches longues,
d'une salopette grise à rayures et porte béret et
nœud papillon de même coloris. L'avorton sent la famille
aisée, tant il a tout du parfait petit gentleman prétentieux.
Même élégance chez ses parents, qui viennent
d'accourir pour découvrir l'impensable : un adolescent squelettique,
vêtu de guenilles sales et chaussé de savates trouées,
dormant dans "leur salon" !
- Qu'est-ce que tu fais là ? interroge un père, cravaté
et blazérisé façon homme d'affaire.
- Je suis revenu.
- "Revenu" ? D'où ?
- Du camp.
L'homme et la femme - chapeau à voilette, tailleur gris souris,
parfumée, poudrederizée et fardée de haut en
bas comme poule de luxe -, de se regarder, en se demandant si je
ne suis pas fou.
- C'est comment ton nom?
- David.
- David comment ?
- Adler.
- Ça ne m’explique pas ce que tu es venu faire chez
nous.
- Ce n'est pas chez vous ! C'est chez moi.
Silence complet. On entendrait une mouche voler.
Et la belle dame de se retourner, tête entre les mains, en
répétant :
- Je me doutais bien que ça ne pouvait pas durer. Je l'ai
toujours dit. Ça devait arriver. Ça devait arriver.
Mon Dieu ! Qu'allons-nous faire ?
Son mari de s'énerver. Puis de tenter de la calmer en la
secouant :
- Tu es entré comment ? Tu n'avais pas la clef.
- Je suis passé par la cave de la remise, après avoir
traversé la cour des voisins. Et j'ai fait sauter le loquet
de la porte du couloir.
- Tu as pénétré chez moi par effraction. C'est
grave, ça.
- C'est faux. Je suis chez nous.
Grand moment de silence, troublé par les pleurs de l'épouse
qui inlassablement répète:
- Mon Dieu ! Mon Dieu ! Je l'avais bien dit.
C'est alors que je leur raconte
tout. Que mon nom, c'est bien David Adler. Que je suis le fils d'Isaac
et d’Hannah Adler. Légitimes propriétaires des
lieux. Qu'un jour, on est venu nous chercher. Ici. Dans Notre maison.
Qu'on nous a emmenés à Drancy, près de Paris.
Puis qu'on nous a conduits en Allemagne, par le train, pour finir
derrière les barbelés de Bergen-Belsen.
- C'était quoi ? Un camp de travail ? coupe le mari.
- Si on veut.
J'enchaîne en expliquant que mon père a été
tué par les Boches. Puis que je suis à la recherche
de ma mère, en espérant que le typhus ne l'ait point
emporté. Puis brûlée dans le four crématoire.
De toute évidence, je me rends compte qu'ils ne me croient
pas.
- Ça suffit tes histoires. Si c'est pour te rendre intéressant,
avec moi, tu perds ton temps.
- Pourtant, c'est vrai.
Seule la mère de s'inquiéter lorsqu'elle a entendu
le mot de "typhus".
- S'agirait pas qu'il nous apporte ses maladies, ce gosse-là,
qu'elle se récrie. En enlaçant son affreux rejeton.
- Rassurez-vous. Si je l'avais, je le saurais.
- C'est quoi le typhus ? questionne-t-elle encore.
- On a de la fièvre et on est plein de boutons.
- Mon Dieu, mon Dieu ! Et ça s'attrape comment ?
- Par les poux.
- Mon Dieu ! Tu as des poux ? s'irrite-t-elle affolée, tout
en jetant un œil sur mon crâne.
(Jamais je n'ai autant souhaité être affecté
par cette maladie, pour la leur "recoller", tellement
ces prétentieux m'insupportent.)
Puis le couple de m'apprendre qu'après
notre départ, la maison a été mise en vente.
Qu'ils l'ont achetée "légalement", insistent-ils.
Et que maintenant elle leur appartient "de leur plein droit".
Même qu'ils peuvent me montrer l'acte de vente rédigé
en bonne et due forme, si je le désire. En outre, l'homme
m'apprend qu'il est également directeur de la scierie de
Varèges. Et que notre habitation n'est qu'un pied-à-terre,
qu'ils comptent prochainement louer. Car ils habitent une grande
propriété chemin du Val Bernay sur la route de Brienne.
Justement, selon eux, ils m'annoncent
que, s'ils sont venus aujourd'hui, c'est parce qu'ils attendent
l'arrivée d'éventuels locataires, pour une visite
des lieux.
Je leur demande ensuite ce que nos tableaux sont devenus. Puis nos
meubles. Or, à cette question, qui semble dérangeante,
ils répondent d'une manière évasive. Toujours
d'après l'homme, ils auraient acquis la demeure en l'état.
Et que le rare mobilier qui a été rajouté,
leur appartient.
Je comprends que je n'ai plus rien à faire ici. Non seulement,
je n'ai plus de parents, mais je n'ai plus de toit non plus. Ce
que me confirme l'industriel :
- Tu ne peux pas rester ici.
À titre de compensation,
la femme de me proposer à manger. Vu qu'ils ont apporté
un panier
pique-nique, dans l'attente de leurs visiteurs. C'est tout ce qu'ils
peuvent faire pour moi, m'est-il
encore précisé.
Partager le repas d'occupants illégaux qui, en outre, m'ont
tout pris et qui vont me mettre aussitôt à la porte,
ne peut se concevoir que si l'on est affamé. Tel est mon
cas. Car j'ai tellement faim que j'accepterais de déjeuner
avec le diable en personne. J'aviserai par la suite.
Et c'est la bouche pleine que je
m'enfile la manne qui m'est si généreusement offerte
par le couple de parvenus. Pain beurré, jambon, cornichon,
fruit et fromage blanc... Que ne fait-on pas avec l'argent des autres
! Je comprends que ces gens-là, malgré leurs grands
airs, sont de moralité douteuse. Ils appartiennent à
la race des parvenus. De celle qui a bien profité de la Collaboration.
La preuve, une fois le repas terminé, l'homme de m'indiquer
la sortie :
- À présent, tu t'en vas.
J'aurais tant aimé prendre
un bain. Fouiller dans les placards de la chambre à la recherche
de mes anciens vêtements - s'il en reste. Puis mes photos
? Où est-il notre album de famille ? L'ont-ils brûlé
?
Mais rien de tout cela ne m'a été proposé.
Tant ils ont hâte de me flanquer dehors.
Avant de manger, on ne m'avait même pas invité à
me laver les mains, tant ils étaient pressés de me
voir partir.
Bref ! Moi, David Adler, fils des propriétaires, de me retrouver
sur le trottoir. Chassé de ma propre maison. Lors que, derrière
moi, j'entends une clef tourner dans la serrure. Me retrouvant de
ce fait, enfermé à l'extérieur. Triste retour
!
Que faire?
C'est la question que je me pose, assis sur les marches, les deux
pieds dans le caniveau. C'est bien la peine de venir d'aussi loin,
de traverser autant de pays, pour me retrouver dans la rue, le dos
appuyé contre une porte close. La mienne.
Mon regard vague de balayer une chaussée quasi déserte.
À part un cycliste qui dévale la pente à bride
abattue pour disparaître, à main gauche, derrière
le virage de la Grand-rue. Sinon, personne. Pas même un chat.
Ah si ! Un couple. Un couple qui cherche quelque chose...
À voir la façon avec laquelle le quidam et la femme
regardent vers le haut, je comprends qu'ils cherchent un numéro
de rue. Ça y est. Ils ont trouvé. Aussi s'arrêtent-ils.
M’aperçoivent. Hésitent. Puis questionnent :
- Monsieur Lebon, c'est bien ici ?
(C'est la première fois que j'entends le nom de mes squatteurs.)
- Ici, c'est chez Adler.
- Adler ? Pourtant, on est bien au 22 rue de Jonquères.
- Hannah et Isaac Adler.
Ils sont embarrassés. Se concertent. Traversent finalement
la chaussée. Se plantent devant moi. Pour aller sonner.
Pas facile d'atteindre la sonnette, vu que je suis assis sur les
marches. L'homme finit toutefois par passer la main au-dessus de
ma tête, sans plus de façon, pour atteindre le bouton.
Nul doute. Ce sont bien les visiteurs qu'attendent mes "coupeurs
de bois".
Je les ennuie. Je le sais. Mais je ne me déplacerai pas.
Puisque je suis chez moi.
- Sauve-toi de là ! Tu vois bien que tu gênes, fait
le bonhomme.
Derrière moi, j'entends des pas. Une clef qui tourne dans
la serrure. La porte qui s'ouvre. Et Lebon - puisque c'est son nom
-, de m'attraper par le col et de violemment me pousser. Je suis
si faible que je tombe, le nez contre le goudron, pendant qu'il
fulmine :
- Encore toi ? Je t'ai dit de foutre le camp de là. Si tu
continues, je vais appeler les gendarmes.
- Monsieur Lebon, c'est bien ici?
- Tout à fait. Entrez, entrez messieurs-dames. On vous attendait.
Puis, se tournant vers moi, les visiteurs déplorent :
- Tu vois petit. Pourquoi tu nous as menti ? C'était bien
là.
- Ne l'écoutez pas. C'est un sale petit mendigot. J'ai beau
le chasser, il revient quand même.
Et faites attention. Il a des poux.
- Des poux !? Oh, mon Dieu, s'écrie la femme, tout en rentrant
précipitamment.
Avant que le reste ne se perde derrière la porte sitôt
celle-ci refermée à double tour, j'ai le temps d'apercevoir
le gamin en train de me fusiller d'un regard méprisant. Pratique
habituelle de gosses de bonne famille bien nourris et à qui
rien ne manque.
Et je reste là. Assis au
beau milieu de la chaussée. Saignant du nez. Puis, à
ce point écœuré que je décide de n'en
plus bouger. Au mépris d'éventuels passants.
Tant pis pour eux et pour les cyclistes qui feront un détour.
Tant pis aussi pour les voitures, qui seront bien obligés
de s'arrêter, vu qu'elles n'auront pas la place pour passer
- la rue étant très étroite. Mais je n'aurai
pas ce plaisir, car celle-ci est si peu fréquentée,
que je ne risque guère de contrarier qui que ce soit.
C'est alors que l'on m'interpelle:
- David...? C'est bien toi ?
- Oui.
- Tu me reconnais ? Monsieur Durand. Gilbert Durand. Ton voisin.
- Oui ?
- Viens chez nous. Tu seras mieux à l'intérieur.
Je m'exécute. Sa femme,
qui m'avait bien vu à travers ses rideaux, me fait entrer
dans sa salle à manger. Me met la tête en arrière.
Me propose un mouchoir pour arrêter ce début de saignement.
Puis m'invite à m'asseoir sur le canapé.
Tous deux ont un souvenir précis du jour de la rafle. Puis
ils m’expliquent qu'à Varèges, nous n'avons
pas été les seuls à partir. Ils me citent des
noms connus, comme les Karp, les Meyer et les Weiss. Lesquels ont
tous été embarqués manu militari...
Or, la gare a beau être petite, dans la foule, dans la peur
et l'agitation du départ, je n'y avais point pris garde.
Ni sur le quai, ni dans les wagons dans lesquels on nous avait jetés
comme des bestiaux, il ne m'avait point été donné
de les côtoyer. Certainement qu'ils ont dû être
dans une autre "voiture", bien que le nom de "voiture"
soit inapproprié vu l'état du train. À telle
enseigne que sur le plancher du nôtre, il restait encore du
purin.
- On aurait bien voulu intervenir,
s'excusent-ils. Mais qu'aurions-nous pu faire ? C'est qu'ils étaient
nombreux, les Boches. D'autant plus qu'il y avait "Nos gendarmes".
On pensait qu'avec eux, cela allait s'arranger. Puis, quand on vous
a vus partir avec des valises, on avait compris que c'était
du sérieux. Bref ! On s'attendait à tout, sauf à
cela.
Je les informe du décès
de mon père, tué au départ de Drancy par les
barbares. Puis notre long périple. Et leur décris
notre arrivée en enfer, avec les déportés décédés
pendant le voyage, que l'on extrait des wagons, et que l'on jette
sur la rampe, tels de vulgaires paquets, au milieu de l'amoncellement
de bagages, sommés que nous avons été, de les
abandonner sur place.
Pour en revenir à maman, aussitôt intégrée
dans un groupe de femmes. Laquelle avait disparu de ma vue dans
la lumière des projecteurs. Escortée comme les autres
par les SS et leurs chiens. Au milieu des aboiements, des larmes
et des cris. Parfois troublés par le bruit des
détonations suivis de brefs gémissements. Enfin de
l'état de santé de ma mère, peut-être
emportée par le typhus. Ce dont je doute de par sa solide
constitution - certitude qui pourtant contredit l'Institut néerlandais
de la santé publique, qui affirme que "la plupart des
décès dus à cette maladie ont lieu douze jours
après l'apparition des premiers symptômes."
Puis je dépeins les conditions
atroces qu'il m'a fallu surmonter pour survivre. Enfin, notre évacuation
précipitée avec des Boches terrorisés, devant
l'avance alliée. Et enfin, ma fuite à pied jusqu'à
Varèges où je viens d'être chassé de
chez moi comme un malpropre.
- Où donc qu'ils vous avaient emmenés?
- À Bergen-Belsen.
- C'est où ?
- En Allemagne, en Basse-Saxe. Dans la lande de Lüneburg.
Entre Hambourg et Hanovre.
- C'est loin.
- J'ai profité de l'arrêt du convoi, la faute à
un train bombardé, qui empêchait la circulation, pour
m'enfuir en pleine nuit... Pour arriver ici, j'ai traversé
la Hollande, la Belgique et le Luxembourg.
- À pied ?!
- Le plus souvent. Pour ne pas être trahi par ma langue. Sinon,
sur des chariots ou des bennes de camions. Quand les chauffeurs
étaient complaisants.
- Pauvre petit !
Ensuite, la conversation de rouler
sur le comportement de leurs voisins - les Lebon. Des propriétaires
de la scierie de Varèges, qui sont rarement là, paraît-il.
Lesquels préférant vivre dans leur superbe demeure
du Val Bernay.
- Ce sont des gens fortunés. Des arrivistes que la guerre
et la collaboration ont enrichis. Pour tout dire, des propres à
rien.
Pour appuyer leur déclaration outrancière, Thérèse
Durand de m’expliquer qu'à peine étions-nous
partis, que des camions de déménagement étaient
venus emporter la plupart de nos meubles et de nos œuvres d'art.
Même que les Lebon étaient présents sur les
lieux. Pour désigner ce qu'il convenait d'emmener ou de laisser
- autrement dit pas grand-chose. C'est Huguette Lebon, la femme
de l'industriel, qui dirigeait les opérations.
Contrairement à mes squatteurs,
ils me croient. Puis s’inquiétant de mon sort, ils
me demandent ce que je compte faire, et si j'ai de la famille susceptible
de m'accueillir.
Je leur réponds que j'attends ma mère. Parce que je
suis persuadé qu'un jour ou l'autre, elle sera de retour.
Tout comme moi qui ai réussi à échapper à
la folie meurtrière des nazis. C'est pourquoi je leur explique
que je ne veux pas m'éloigner de notre maison. Car s'il y
a un endroit où elle reviendra, c'est ici, rue de Jonquères.
Quant à ma famille, certes, si nous n'avons plus nos grands-parents,
nous avons encore des cousins à Chaumont, à Paris
ou à Châtellerault. Mais, comment les contacter ? Puis,
que sont-ils devenus, après la terrible purge exercée
par Hitler et ses sbires, à l'encontre des Juifs ?
- Reste ! me fait-elle. C'est ici que tu vas l'attendre, ta maman.
Gilbert va s'occuper de toi. Le temps de recouvrer tes droits.
Au fait, on parle, on parle, mais tu as peut-être faim?
- Ils m'ont donné un sandwich.
- Quelle générosité!
- Par contre, ce que je voudrais, c'est dormir.
- Je monte et je te prépare un lit. Viens m'aider Gilbert.
On va déplier le lit-cage. Tu verras comme tu vas être
bien.
À peine sont-ils partis que je m'écroule sur leur
canapé. Ivre de fatigue.
...........................................................................À
SUIVRE

![]()
 Épuisé
Épuisé Épuisé
Épuisé